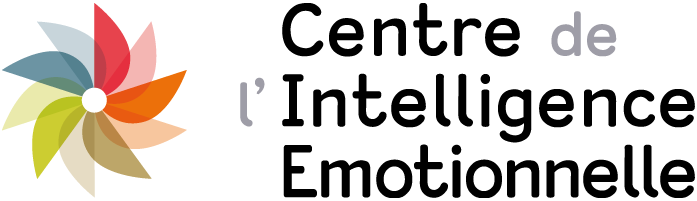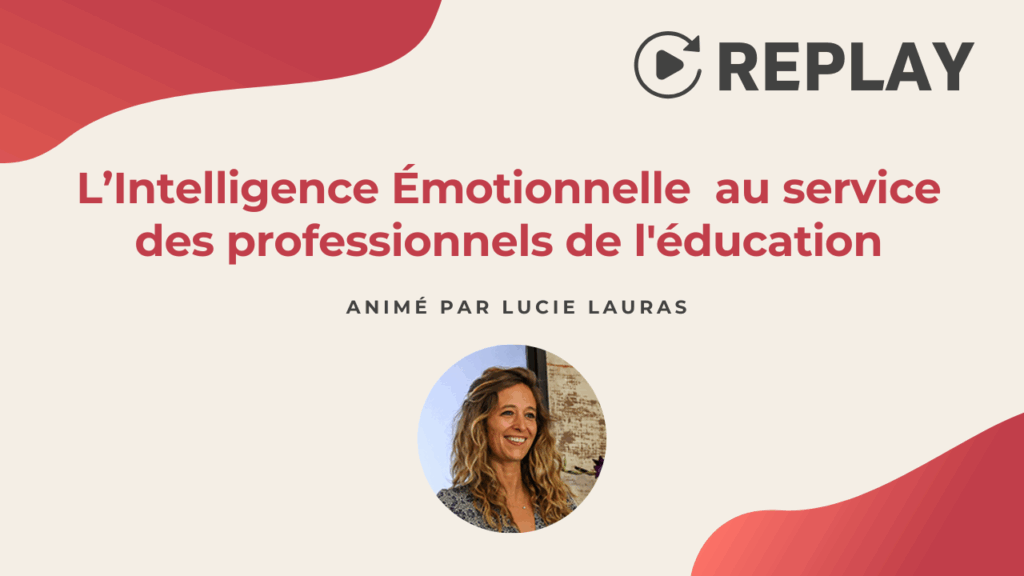Oser la confiance
Faire confiance, un acte fondateur
Dire “Je vous fais confiance” est bien plus qu’un énoncé bienveillant. C’est un pari risqué, une déclaration d’engagement personnel, et surtout un choix profondément humain. Dans un monde professionnel traversé par l’incertitude, l’hybridation des formes de travail et la pression sur les résultats, la confiance s’impose comme une ressource à la fois fragile et essentielle. Cet article propose une exploration à plusieurs niveaux de la confiance, non seulement comme valeur, mais aussi comme levier de performance durable et de bien-être collectif.
Un engagement et une vulnérabilité assumée
La confiance n’est pas un affect, ni une simple émotion. Elle est une disposition active, une posture de l’esprit, un choix volontaire face à l’inconnu. Comme l’affirme Niklas Luhmann, elle permet de réduire la complexité du monde en nous évitant de tout contrôler¹. Faire confiance, c’est accepter de déléguer, de s’ouvrir, d’être vulnérable.
Cet engagement prend racine dans l’humain lui-même : l’être humain naît dans un état de dépendance totale. Ce “pari inaugural” fonde sa relation au monde et à l’autre. C’est cette vulnérabilité fondatrice qui rend possible toute relation, y compris professionnelle.
Une dynamique multidimensionnelle
La confiance peut être envisagée sous trois angles complémentaires :
- Intrapersonnelle : Confiance en soi, en ses capacités à agir malgré l’incertitude, selon la théorie de l’auto-efficacité de Bandura².
- Interpersonnelle : Confiance dans l’autre, dans ses intentions et sa cohérence.
- Organisationnelle : Confiance dans le système, dans les règles du jeu, dans l’institution.
Ces niveaux sont interconnectés. Une atteinte à l’un fragilise l’ensemble. C’est pourquoi toute action sur la confiance doit tenir compte de ses ramifications cognitives, émotionnelles et relationnelles.
L’intelligence émotionnelle : catalyseur de la confiance
L’Intelligence Émotionnelle (IE) joue un rôle déterminant dans la régulation de la confiance :
- Identifier les émotions : Nommer ce que l’on ressent dans les moments de tension.
- Comprendre leur impact : La peur alimente la méfiance, la colère pousse à la confrontation, la confiance ouvre à la collaboration.
- Transformer : Utiliser ses émotions comme des ressources pour agir de façon alignée, responsable et constructive.
L’IE, conceptualisée notamment par Daniel Goleman, est un outil puissant pour construire un climat de sécurité psychologique, essentiel au développement de la confiance dans les équipes³.
La confiance comme construction progressive
La confiance n’est ni donnée ni acquise une fois pour toutes. Elle se construit dans le temps, à travers :
- La parole authentique : Parler est un engagement, bien plus que de simplement communiquer.
- La valorisation des réussites : Chaque succès renforce le lien.
- La gestion des échecs : L’échec n’est pas trahison ; il devient une opportunité de redéfinir le contrat de confiance.
La confiance se nourrit d’exemples, de rituels, d’espaces d’expression. Elle implique une posture active face à l’autre, une reconnaissance mutuelle de l’humanité partagée.
Pratiques pour une culture de confiance en entreprise
À titre individuel :
- Travailler son sentiment d’efficacité personnelle (Bandura)
- S’entraîner à la régulation émotionnelle
- Aligner émotions, paroles et actions
- Prendre des risques mesurés (micro-confiance)
À l’échelle collective :
- Instaurer une communication ouverte et respectueuse
- Valoriser le droit à l’erreur
- Tenir ses engagements
- Privilégier la qualité des liens à la performance immédiate
La confiance, boussole de l’avenir
La confiance est une attitude, un choix éclairé face à l’incertitude, une force d’adaptation plus qu’un confort. Elle ne garantit ni l’absence de conflit, ni celle d’échec ou d’erreur. Mais elle permet de traverser ces épreuves avec cohérence, lucidité et ouverture. Elle est ce pont fragile mais vital entre l’individu et le collectif, entre le je vulnérable et le nous solidaire.
Il existe une manière profonde d’envisager la confiance : comme une posture d’existence. Une manière d’être au monde, faite d’assurance tranquille, de lâcher-prise partiel, de foi raisonnée en ce qui n’est pas encore. Elle ne consiste pas à tout contrôler, mais à avancer malgré l’incertitude, à partir de signaux perçus comme suffisamment sûrs pour s’engager.
Dans cette attitude, la confiance devient un moteur de responsabilité. Elle donne envie de tenir parole, d’honorer le regard de l’autre qui croit en nous. Ce regard bienveillant agit comme une force d’élévation. Comme le résume Charles Pépin, « faire confiance, c’est oser un saut vers l’autre »⁴. Un saut sans garantie, dans un monde que notre cerveau interprète souvent comme menaçant.
Et pourtant, là où il y a confiance, il y a puissance d’agir. Des recherches en psychologie ont montré que la confiance augmente la résilience, stimule l’engagement, favorise la créativité et soutient la résolution des problèmes complexes⁵.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la confiance n’est ni naïveté, ni idéalisme. Elle est une condition d’action, un socle invisible mais essentielpour innover, collaborer, se relier.
Faire confiance, c’est assumer le risque d’aimer, de collaborer, de construire… et d’échouer.
Article rédigé par Lucie Lauras
Références
- Luhmann, N. (2006). La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale. Éditions Economica.
- Bandura, A. (1977). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review.
- Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
- Pépin, C. (2018). La confiance en soi. Une philosophie. Allary Éditions.
- Seligman, M.E.P. (2011). La fabrique du bonheur (Flourish). Les Arènes ; études sur la confiance et la résilience en psychologie sociale.