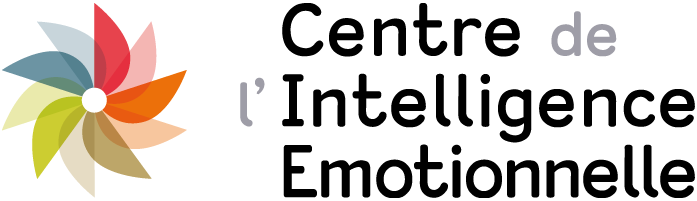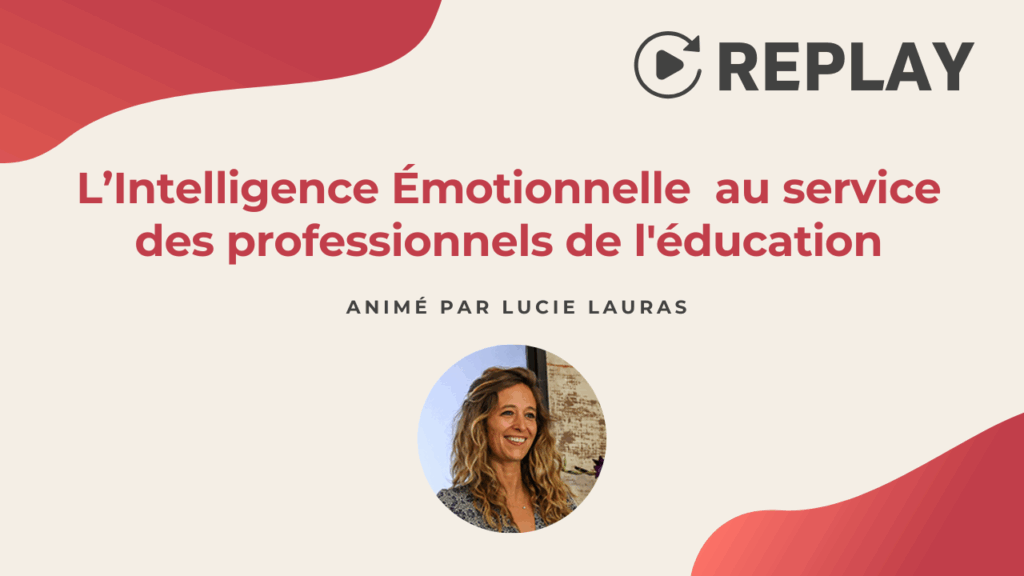L’expression de soi comme processus de construction de l’identité
L’expression de soi est un processus fondamental dans la construction de l’identité personnelle et sociale. Plus qu’une simple externalisation des pensées ou des émotions, elle constitue un phénomène dynamique, complexe et multidimensionnel, influencé par des facteurs sociaux, culturels, émotionnels et contextuels. Cet article se propose d’explorer l’expression de soi dans ses diverses facettes, en fusionnant les approches théoriques avec des exemples pratiques issus des réflexions menées par les membres du comité de recherche du Centre de l’intelligence émotionnelle[1] lors de leur dernière rencontre en s’appuyant sur les articles[2] lus en préparation. Nous analyserons comment l’expression de soi est un processus structurant, transformateur, intersubjectif et adaptable selon les contextes sociaux. Enfin, nous aborderons les notions d’assertivité et d’estime de soi, deux éléments clés pour une expression authentique et équilibrée.
L’Expression comme processus structurant et transformateur
Contrairement à une vision statique de l’expression comme simple communication d’idées, de nombreux théoriciens soulignent son rôle actif dans la structuration de la pensée et de l’identité. L’expression, au sens premier du terme, c’est « faire sortir (notre identité) en pressant ». Lev Vygotsky[3], psychologue et pionnier de la théorie socioculturelle, soutient que le langage ne se contente pas de refléter des pensées, mais participe activement à leur formation. En d’autres termes, c’est en verbalisant nos idées que nous les structurons, les comprenons et les organisons.
Cette perspective rejoint celle de Jean-Marie Robine[4], qui soutient que l’expression de soi est façonnée par l’interaction entre l’individu et son environnement. Prenons l’exemple d’une personne confrontée à un dilemme personnel : en parler avec un ami ou un thérapeute peut lui permettre d’organiser ses pensées, de clarifier l’impact émotionnel de cette situation et de prendre des décisions concrètes et adaptées. Ce processus souligne l’idée que l’expression de soi n’est pas un acte figé, mais un moyen actif d’organiser ses expériences subjectives.
Cette approche s’illustre également par les travaux de John Dewey[5], philosophe et psychologue américain, sur l’expérience esthétique et le rôle de l’expression artistique. Selon lui, la création artistique est un acte structurant, non seulement pour l’artiste, mais aussi pour le spectateur, car elle réorganise les expériences émotionnelles et intellectuelles. La dimension transformative de l’expression, c’est permettre à l’acte créatif de jouer un rôle crucial dans la clarification et la compréhension de soi. Cela s’applique aussi à des formes d’expression plus ordinaires, comme l’écriture ou le dialogue, où la mise en mots des émotions participe activement à leur structuration et compréhension. Une « lettre de colère » peut par exemple grandement aider à poser des mots sur un sentiment d’injustice qui ne peut, pour diverses raisons, être exprimé oralement. Son effet libérateur est souvent appréciable.
L’intersubjectivité et la construction de l’identité
L’expression de soi ne se fait jamais dans l’isolement, elle est façonnée par les interactions sociales et les échanges symboliques. La notion d’intersubjectivité – c’est-à-dire l’interaction entre deux ou plusieurs individus – introduite par le philosophe Edmund Husserl[6] et développée par Maurice Merleau-Ponty[7], souligne que l’individu se construit dans et par ses relations avec autrui. Selon Merleau-Ponty, l’identité individuelle est toujours en devenir, influencée par l’environnement social et les interactions avec les autres. La manière dont les autres réagissent à nos expressions contribue donc à façonner notre perception de nous-mêmes.
Le « soi » est un produit social, notre perception de nous-mêmes évolue en fonction des rôles que nous jouons dans la société et des feedbacks que nous recevons de nos pairs. Ainsi, l’identité est un processus fluide, en perpétuelle évolution.
Nous avons l’exemple d’une personne adoptée à quinze mois qui, au fil des ans, a perdu tout contact avec ses racines culturelles. À 45 ans, elle reçoit une lettre de sa mère biologique, écrite dans une langue tribale dont elle n’avait aucune connaissance. À la lecture des mots en miéné, elle ressent une vague d’émotions enfouies. Ce simple acte de lecture réveille des éléments de son identité. Cet exemple montre comment l’intersubjectivité, ici symbolisée par la langue, peut réactiver des aspects profonds de l’identité, reliant ainsi l’individu à une part oubliée de lui-même.
Dans un cadre plus professionnel, cette intersubjectivité joue également un rôle crucial. Les attentes sociales et les normes de conduite imposées dans les milieux professionnels peuvent obliger les individus à moduler leur expression de soi, créant ainsi des tensions entre authenticité et conformisme. Erving Goffman[8], dans son analyse des interactions sociales, parle de la « mise en scène de soi », où chaque individu adapte son comportement en fonction du « rôle » qu’il joue dans une situation donnée. Un médecin, par exemple, n’adoptera pas la même manière de parler avec ses patients, ses collègues ou sa famille, car : chacun de ces contextes impose des normes et des enjeux différents.
L’influence des contextes sociaux sur l’Expression de Soi
L’expression de soi est également profondément influencée par le contexte social. Les individus ajustent continuellement leur manière de s’exprimer en fonction des normes implicites et explicites de leur environnement. A la question « qui êtes-vous ? », les réponses varieront en fonction du contexte et de ce que nous décidons de mettre en avant ( un nom, une fonction, une identité sociale, familiale, politique…). En psychologie sociale, Festinger[9] a démontré d’ailleurs à travers sa théorie de la comparaison sociale que les individus tendent à évaluer leurs propres comportements et expressions en fonction de ceux des autres. Mon identité affirmée va alors dépendre du projet de celui qui l’écoute et de sa propre identité.
Dans ce contexte, Goffman met en lumière la flexibilité de l’identité et la manière dont nous modifions notre comportement en fonction des attentes de chaque situation. Prenons l’exemple d’un professionnel qui se présente différemment lors d’une réunion formelle au travail et lors d’une conversation décontractée entre amis. Cette capacité à moduler l’expression de son identité est une forme d’adaptation sociale, mais elle peut aussi entraîner des tensions lorsque l’individu se sent trop éloigné de ce qu’il estime être son soi véritable.
Le syndrome de l’imposteur est un exemple de cette tension interne. Des études, notamment celles de Clance et Imes[10], montrent que les personnes qui éprouvent ce sentiment ressentent souvent un décalage entre leur réussite publique et leur ressenti interne. Par peur de ne pas être à la hauteur des attentes ou d’être démasquées, elles ajustent continuellement leur expression pour se conformer aux normes sociales, ce qui peut créer un malaise profond. Ces études montrent que ce phénomène est particulièrement courant chez les individus qui évoluent dans des milieux où les attentes sociales sont très élevées.
Assertivité et gestion de l’impulsivité dans l’Expression de Soi
L’assertivité est une compétence clé dans l’expression de soi. Alberti et Emmons[11] définissent l’assertivité comme la capacité à exprimer ses émotions, besoins et droits de manière directe et respectueuse, sans céder à l’agressivité ou à la passivité.
Daniel Goleman, dans ses travaux sur l’intelligence émotionnelle, met en avant l’importance de la régulation émotionnelle[12] dans ce processus. L’assertivité permet à un individu de réguler ses émotions pour éviter des comportements impulsifs, voire agressifs, qui pourraient compromettre ses relations.
Cette compétence est particulièrement cruciale dans les environnements professionnels, où l’individu doit trouver un équilibre entre l’affirmation de soi et la gestion de ses émotions pour éviter des réactions impulsives nuisibles.
Un individu capable de maîtriser ses émotions et d’éviter des comportements impulsifs est en mesure de maintenir des relations saines et respectueuses, tant dans sa vie personnelle que comme professionnelle. L’assertivité permet également de limiter les comportements passifs, qui engendrent frustration et à des conflits latents (Linehan[13]).
Imaginons un manager qui doit formuler des critiques à son équipe. S’il ne maîtrise pas ses émotions et réagit de manière impulsive, il risque de compromettre ses relations professionnelles. Au contraire, s’il adopte un comportement passif et ne dit rien, des frustrations et des non-dits peuvent tout autant les compromettre. En revanche, un manager assertif saura formuler ses critiques de manière constructive et recevable. L’assertivité permet ainsi de maintenir une communication claire, respectueuse et productive, tout en tenant compte de l’impact émotionnel de ses propos.
L’impact de l’Estime de soi sur l’Expression de Soi
L’estime de soi joue un rôle fondamental dans l’expression de soi. Carl Rogers[14], dans son approche centrée sur la personne, a mis en évidence l’importance de la congruence et de l’authenticité dans le développement de l’estime de soi. Une forte estime de soi stable permet à l’individu de s’exprimer de manière authentique : il se sent en sécurité et confiant face à l’opinion des autres[15], tandis qu’une faible estime de soi peut limiter cette expression ou, au contraire, conduire à des comportements excessifs pour compenser un sentiment d’insécurité.
La peur d’être mal perçu ou rejeté, mais aussi la difficulté à exprimer sereinement sa vulnérabilité, peuvent engendrer des difficultés d’expression et des tensions internes. Les recherches de Coopersmith[16] ont montré que les personnes ayant une faible estime de soi d’eux-mêmes sont plus enclines à réprimer leurs émotions, ce qui limite leur capacité à communiquer authentiquement et à nouer des relations interpersonnelles épanouies. Cette inhibition peut également conduire à des comportements compensatoires, où l’individu cherche par son expression à surjouer ou à manipuler pour rassurer un profond sentiment d’insécurité.
Renforcer l’assertivité : méthodes et techniques
L’assertivité est une compétence clé dans la gestion des interactions sociales, notamment dans les environnements professionnels où la communication efficace est essentielle pour maintenir des relations équilibrées et éviter les conflits.
La base de l’assertivité repose sur la capacité à utiliser des techniques de communication claires et efficaces, notamment fondées sur les principes de la Communication Non Violente. Ces techniques incluent l’utilisation de phrases en « je » pour exprimer ses sentiments et besoins de manière non accusatrice. Par exemple, au lieu de dire « Tu ne m’écoutes jamais », il serait plus assertif de dire « Je me sens frustré.e lorsque je ne me sens pas écouté.e , j’aurais besoin de moments d’échange seul à seul.e avec toi ». Ce type de communication permet de transmettre son message sans blâmer l’autre, ce qui réduit les risques de conflit.
La reformulation et l’écoute active servent également efficacement l’assertivité. En reformulant ce que l’interlocuteur a exprimé, on s’assure d’avoir bien compris ses propos tout en lui démontrant de l’attention et de la considération. Cette technique, tout en validant les émotions de l’autre, permet aussi de rendre explicites ses propres besoins et de maintenir une communication équilibrée.
La conscience de soi émotionnelle[17] est également une compétence indispensable à l’assertivité. Daniel Goleman souligne que la capacité à identifier et à comprendre ses propres émotions permet d’adopter une posture assertive dans les interactions. En étant conscient de ses émotions, une personne est plus à même de les réguler et de les exprimer de manière constructive, sans se laisser submerger ou emporter. De plus, cette conscience permet de mieux accueillir et comprendre les émotions de l’autre, ce qui renforce la qualité des échanges et des relations.
Conclusion
L’expression de soi est un processus qui transcende la simple extériorisation des émotions ou des pensées. Cet article met en évidence la manière dont l’expression de soi contribue à la construction de l’identité à travers les interactions sociales, tout en étant influencée par des facteurs contextuels et psychologiques. Les théories de la Gestalt-thérapie, les concepts d’intersubjectivité et les études sur l’estime de soi montrent que l’expression de soi est un phénomène dynamique et transformateur, essentiel à la structuration de l’expérience humaine dans des contextes sociaux et professionnels variés. Pour naviguer dans ces multiples contextes, il est nécessaire de développer des compétences telles que l’assertivité, la régulation émotionnelle et une estime de soi solide, afin de s’exprimer et de maintenir des interactions authentiques et constructives.
[1] Lucie Lauras, Christele Camelis, Catherine Denner, Boris Lehmann, Georges Pichoud, Bernard Anselem et Sophie Gicquel
[2] Les articles : « L’expression insiste, l’impression existe » de Jean-Marie Robine, « L’Identité individuelle et les contextualisations de soi » d’Alex Mucchielli, « Culture de soi et expression de soi : critiques philosophiques et anthropologiques » de Pierre Statius et « Agressivité, impulsivité et estime de soi » de Richard Pfister, Cécile Masse, Jérôme Jung
[3] Lev Vygotsky – Psychologue et pionnier de la théorie socioculturelle, soutenant que le langage structure activement la pensée (1934).
[4] « L’expression insiste, l’impression existe » de Jean-Marie Robine – Gestalt-thérapie
[5] John Dewey – Philosophe et psychologue américain, qui a travaillé sur l’expérience esthétique et l’expression artistique comme processus structurant (1934). L’Art comme expérience. Paris: Gallimard.
[6] Edmund Husserl – Philosophe, introduit le concept d’intersubjectivité, définie comme l’interaction réciproque entre individus, soulignant que l’identité se construit dans et à travers les relations sociales.
[7] Maurice Merleau-Ponty – Philosophe, qui a développé la notion d’intersubjectivité et analysé comment l’individu est façonné par ses interactions avec autrui. Phénoménologie de la perception (1945). Paris: Gallimard.
[8] Erving Goffman – Sociologue, connu pour ses théories sur la mise en scène de soi et l’adaptation des comportements en fonction des contextes sociaux. La présentation de soi dans la vie quotidienne (1959)
[9] Festinger – Psychologue, à l’origine de la théorie de la comparaison sociale, expliquant comment les individus évaluent leur propre comportement en se comparant aux autres.
[10] Clance et Imes – Chercheuses ayant travaillé sur le syndrome de l’imposteur, montrant les tensions entre les attentes sociales et le ressenti interne
[11] Alberti et Emmons – Connu pour leurs travaux sur l’assertivité et la définition de cette compétence. Your Perfect Right: Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships. Impact Publishers. (1970).
[12] Les stratégies de régulation émotionnelle | LinkedIn
[13] Linehan, M. M. (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: Guilford Press.
[14] Rogers, C. R. (1959). A Theory of Therapy, Personality and Interpersonal Relationships as Developed in the Client-centered Framework. In Koch, S. (Ed.), Psychology: A Study of a Science (Vol. 3, pp. 184-256). New York: McGraw-Hill.
[15] L’Estime de Soi : une exploration approfondie | LinkedIn
[16] Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-Esteem. San Francisco: W. H. Freeman & Co.
[17] Centre IE | L’EQ-i 2.0 (centreintelligenceemotionnelle.com)