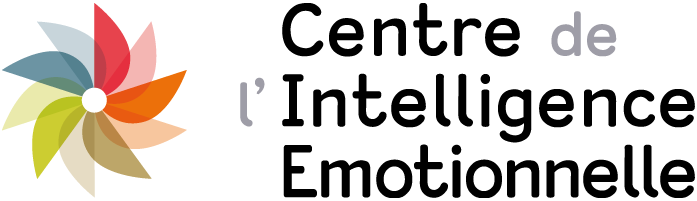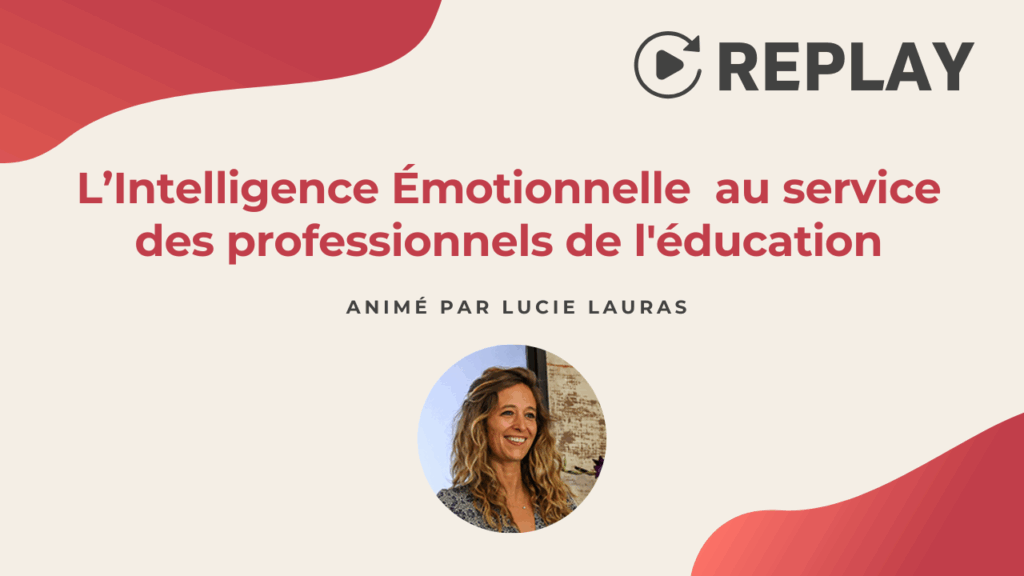La résolution de problèmes
Penser dans la complexité, agir avec discernement
Entreprises, institutions et individus évoluent aujourd’hui dans un environnement instable, ambigu et interdépendant. Dans ce monde en mutation, analyser une cause pour opposer une solution ne suffit plus. Résoudre un problème, c’est accepter le mouvement permanent, accueillir des perspectives multiples, tolérer l’incertitude — et faire émerger, dans l’imperfection, une voie d’action possible.
Ce travail ne relève pas uniquement de la logique : il mobilise l’intelligence émotionnelle (IE)[1]. Car toute décision naît d’une tension : un inconfort, une inquiétude, une alerte. L’émotion n’est pas un bruit parasite, mais un signal stratégique, à écouter avec lucidité.
Issu de la dernière réunion du Comité de recherche du Centre de l’intelligence émotionnelle, cet article propose une approche intégrative de la résolution de problèmes : non comme un geste technique, mais comme une posture. Penser avec rigueur, ajuster dans la relation, décider sans certitude.
L’émotion comme levier de lucidité
L’émotion est souvent la première manifestation du problème. Elle signale un écart entre ce que nous attendions et ce que nous percevons. James Gross, dans son modèle de régulation, identifie la résolution de problème comme une stratégie adaptative : en modifiant notre compréhension d’une situation ou notre manière d’y répondre, nous transformons aussi notre état émotionnel[2].
Ce renversement est essentiel : le problème n’est pas d’abord pensé, il est ressenti. L’affect précède la cognition. Il oriente l’attention, nourrit l’intuition, ouvre un espace d’exploration.
Daniel Kahneman a montré ce mécanisme à travers deux systèmes de pensée :
- Le système 1, rapide, intuitif, anticipe et juge spontanément.
- Le système 2, plus lent et analytique, ne se mobilise que si le contexte le permet : temps disponible, niveau de stress, urgence, nature de la situation.
C’est ici que l’intelligence émotionnelle joue son rôle décisif : reconnaître l’émotion, lui donner sens, crée un intervalle entre le stimulus et la réponse.
C’est dans cet espace que peut surgir une décision plus incarnée et efficace.[3]
Modèles mentaux : penser vite ou penser juste ?
Nous ne voyons jamais le réel[4] tel qu’il est. Nous le filtrons à travers nos modèles mentaux, forgés par l’expérience, la mémoire, l’éducation, nos valeurs. Ces représentations nous aident à agir vite, mais elles peuvent aussi nous enfermer.
Le crash du vol Air France 447 en 2009 l’a montré tragiquement : confrontés à une panne inédite, les pilotes ont interprété les données avec un schéma inadapté, renforcé par le stress[5]. À l’inverse, dans d’autres situations, des pilotes moins expérimentés ont su improviser face à l’inconnu, mobilisant régulation émotionnelle, souplesse et créativité.
Jacques Fradin[6] distingue deux modes mentaux :
- le mode automatique, rapide, économique, efficace, mais rigide et routinier ;
- le mode adaptatif, lent, exploratoire, plus exigeant mais aussi plus créatif.
Passer de l’un à l’autre suppose de résister à l’urgence, de tolérer le doute, d’accepter l’inconfort. C’est là que l’intelligence émotionnelle fait la différence : elle permet de repérer les automatismes induits par le stress, de déjouer les biais, et d’ouvrir l’accès à une posture plus ajustée.
La construction du problème
Un problème n’est jamais donné, il est construit. Il naît d’une interaction entre une personne et ses émotions d’une part et un contexte et ses représentations d’autre part. Ce que nous appelons “problème” dépend de notre manière de nommer une situation.
Le chercheur Stellan Ohlsson[7] montre que les blocages ne viennent pas du manque d’information, mais de la rigidité cognitive. L’exercice des neuf points (carré formé de 9 points disposés en 3 lignes de 3 à relier par 4 lignes droites[8] ) en est un exemple : la contrainte est imaginaire, mais la plupart la respecte, sans la remettre en question et sortir du cadre. Ce n’est pas ici la consigne qui limite mais bien notre manière de penser.
Penser un problème, c’est donc déconstruire nos évidences, oser élargir notre regard, déplacer notre cadre mental. Cela demande du courage intellectuel et, là encore, une lucidité émotionnelle.
Penser en situation : la cognition incarnée
La théorie de la cognition située prolonge cette perspective[9]. Elle affirme que la pensée ne se développe pas en dehors du monde, mais dans le monde : elle est influencée par notre corps, nos gestes, nos outils, nos interactions. Penser, c’est toujours penser en contexte.
Résoudre un problème n’est donc pas simplement « chercher la bonne réponse dans sa tête ». C’est reformuler le problème en cours d’action, en fonction des ressources, des contraintes et des acteurs présents. La perception elle-même dépend de notre rôle, de nos émotions, de nos habitudes. L’intelligence émotionnelle nous aide à repérer ces filtres, à moduler leur effet, à garder une pensée ouverte.
La relation comme matrice de résolution
Un problème n’est jamais purement individuel. Il se transforme dans la relation, au gré des interactions. Il se construit collectivement, par confrontation des points de vue, ajustement des contraintes, reformulation partagée.
Dans cette optique, le modèle des quatre cadrages (Four Deck)[10] offre un outil utile pour clarifier une tension ou un désaccord :
- Et si nous ne parlions pas du même problème ? (cadrage divergent)
- Et si la difficulté venait de nos rôles ou de nos attentes implicites ? (cadrage interactionnel)
- Et si le blocage venait de la manière dont le sujet est abordé ? (cadrage sur la forme)
- Et si cette tension révélait une opportunité d’évolution collective ? (cadrage émergent)
L’enjeu n’est pas de trancher, mais d’ouvrir. Suspendre l’interprétation immédiate, croiser les regards, ancrer la résolution dans une pensée relationnelle active.
Agir ou lâcher prise ?
La résolution de problèmes ne revient pas toujours à solutionner. Certains problèmes sont insolubles dans les paramètres donnés ou exigent un coût émotionnel ou énergétique disproportionné. Dans ces cas, le vrai enjeu devient la gestion de soi face à notre impuissance.
Le modèle du coping, proposé par Lazarus et Folkman[11], distingue deux stratégies : agir sur le problème ou agir sur son impact émotionnel. Quand l’action est impossible, c’est la réévaluation cognitive qui devient essentielle[12]. Renoncer, ici, n’est pas un échec, c’est un choix lucide et salvateur.
Cette posture est précieuse dans les environnements contraints, figés ou injustes. Il ne s’agit pas de se résigner, mais de se recentrer : qu’est-ce qui dépend de moi ? Que suis-je prêt à lâcher ? Où puis-je investir mon énergie utilement ?
Viktor Frankl le formulait ainsi :
« Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans cette réponse résident notre croissance et notre liberté. »[13]
Ce discernement émotionnel repose sur une lecture claire de la situation. Et c’est là que la stratégie de réévaluation cognitive, chère à James Gross, prend tout son sens : reconstruire le sens d’une situation pour en réduire l’impact. Ce n’est pas contourner le réel, c’est retrouver une forme de pouvoir intérieur.
La résolution de problèmes, lorsqu’elle est abordée à travers le prisme de l’intelligence émotionnelle, s’ancre en effet dans une posture existentielle : celle de l’autonomie émotionnelle. Elle ne consiste pas à tout maîtriser, ni à se couper de l’émotion, mais à développer une capacité d’ajustement lucide au sein d’un système complexe. Une posture dans laquelle l’individu n’est ni totalement impuissant, ni totalement maître.
Le psychiatre et philosophe que nous venons de citer, Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis a profondément influencé la pensée contemporaine sur le sens, la liberté intérieure et la résilience. Il insistait sur ce qu’il appelait « la dernière des libertés humaines » : même dans les conditions les plus extrêmes, l’être humain conserve la capacité de choisir sa réponse à ce qu’il traverse. Cette liberté — parfois minime, mais toujours réelle — fonde notre dignité et notre puissance d’agir.
Concrètement, cela implique la capacité à :
- Identifier les contraintes auto-imposées qui restreignent notre champ d’action,
- Nommer avec précision l’émotion dominante en jeu,
- Formuler des hypothèses de solution en cohérence avec nos ressources, nos limites et nos valeurs.
L’indépendance émotionnelle[14] devient alors un levier de lucidité décisionnelle : elle ne nie pas les contraintes, mais les transforme en données avec lesquelles composer. Elle permet d’éviter le déni comme l’épuisement, pour choisir un engagement juste.
Conclusion
Les travaux du comité de recherche sur la résolution de problèmes montrent combien cette compétence est multidimensionnelle. Elle engage :
- des processus de régulation (acceptation, réévaluation, flexibilité cognitive),
- des enjeux éthiques (ne pas s’acharner là où l’on n’a aucun levier),
- des dimensions relationnelles (négocier, co-construire, poser des limites),
- des facteurs structurels (environnement, culture, outils numériques).
Résoudre, c’est construire le problème avec son environnement. C’est accepter qu’il n’y ait pas toujours une solution unique, ni une trajectoire linéaire. Parfois, la résolution consiste à reformuler le cadre, à transformer le problème en opportunité d’apprentissage — ou à lâcher prise lucidement.
À l’heure où l’intelligence artificielle, la complexité croissante des organisations et la diversité cognitive redéfinissent nos manières d’agir, cette compétence mérite d’être réhabilitée. Elle ne se limite pas à l’efficacité : elle intègre l’humain, l’adaptation et la réflexivité.
Renforcer la résolution de problèmes, c’est :
- Cultiver la tolérance à l’incertitude,
- Développer une lecture fine des contraintes,
- Accompagner la métacognition émotionnelle,
- Encourager une décision éthique, informée et incarnée.
En somme : penser dans la complexité, avec l’émotion, pour l’action.
[1] La résolution de problèmes est une des 15 compétences de l’intelligence émotionnelle, selon le modèle du Dr Reuven Bar-On. Elle se trouve dans la dimension prise de décision
[2] Gross, J.J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299.
[3] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
[4] Le sens de la réalité est une des 15 compétences de l’intelligence émotionnelle, selon le modèle du Dr Reuven Bar-On.
[5] Should Airplanes Be Flying Themselves? | Vanity Fair
[6] Fradin, J. (2006). L’intelligence du stress. Eyrolles.
[7] Ohlsson, S. (1992). Information-processing explanations of insight and related phenomena. In M. Keane & K. Gilhooly (Eds.), Advances in the Psychology of Thinking. Harvester-Wheatsheaf
[9] Clancey, W. J. (1997). Situated Cognition: On Human Knowledge and Computer Representations. Cambridge University Press
[10] Le modèle des quatre cadrages (Four Deck) est utilisé en design stratégique, en intelligence collective et en accompagnement du changement. Il vise à ouvrir la pensée sur des situations complexes ou conflictuelles par une confrontation raisonnée de plusieurs hypothèses.
[11]Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal, and Coping. Springer.
[12] Voir article sur les stratégies de régulation émotionnelle : Centre de l’intelligence émotionnelle | Les stratégies de régulation émotionnelle
[13] Frankl, V. E. (1946). Man’s Search for Meaning. Beacon Press
[14] L’indépendance émotionnelle est une des 15 compétences de l’intelligence émotionnelle selon le modèle de Bar-On