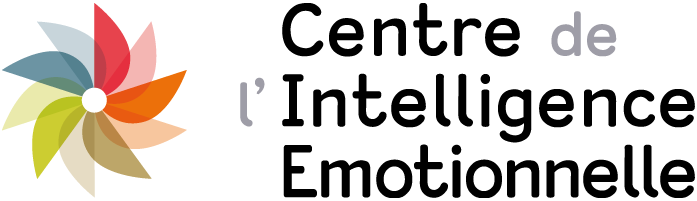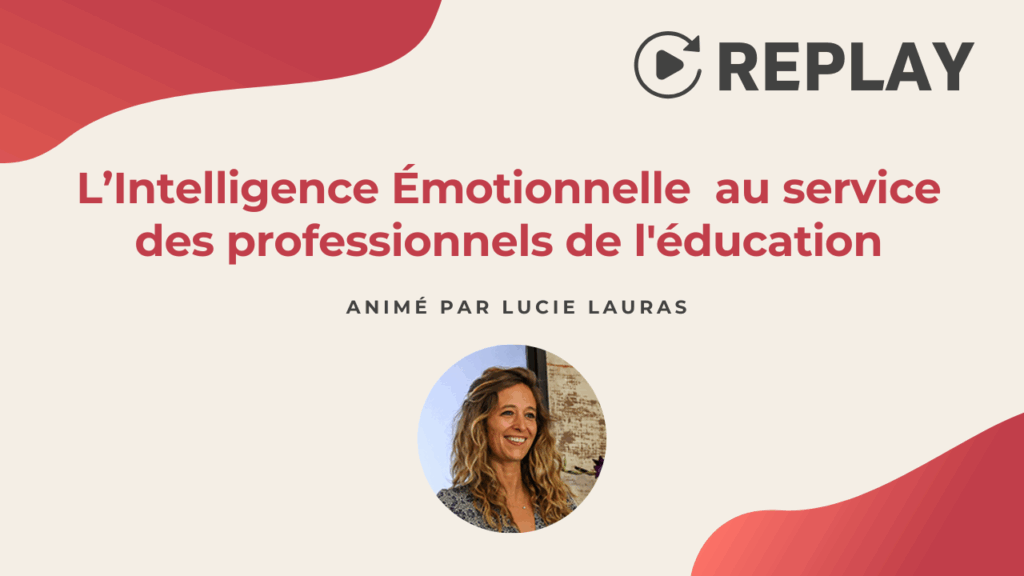La Culpabilité : de l’auto-jugement à la responsabilité vivante
« Il n’est pas de pire tyran que notre propre conscience. » — Sénèque[1]
Il est des douleurs silencieuses qui n’ont ni visage ni témoin. Des blessures sans plaie, infligées par une voix que nul n’entend sauf nous. Cette voix, c’est celle de la culpabilité.
Dans la tragédie grecque, nulle figure ne cristallise mieux ce vertige que celle d’Œdipe[2]. Il tue son père, épouse sa mère, sans le savoir. Lorsqu’il découvre l’horreur de sa destinée, il ne fuit pas. Il ne nie pas. Il s’aveugle lui-même, non par peur du châtiment, mais en écho à une loi intérieure transgressée, à une dette morale qu’il sent irrémissible — et qu’aucun tribunal ne lui avait pourtant adressée.
Ce n’est pas le regard des autres qui le juge. C’est le sien.
La culpabilité n’attend pas qu’on soit déclaré coupable aux yeux de la loi ou de la société. Elle surgit lorsque notre propre éthique intime se trouve trahie, parfois même à notre insu. C’est en cela qu’elle est redoutable : elle ne s’appuie pas toujours sur les faits, mais sur la représentation intérieure du mal, sur l’écart douloureux entre ce que nous avons fait et ce que nous croyons devoir être.
Et alors commence le double visage de cette émotion. Elle peut nous éveiller, nous responsabiliser, nous pousser à la réparation sincère. Mais elle peut aussi nous enfermer dans la rumination, l’autopunition, l’indignité. Elle peut être un lien, ou un isolement.
Anatomie d’une émotion complexe
La culpabilité n’est ni un simple réflexe, ni une émotion primitive. Elle relève d’une élaboration psychique, culturelle et narrative. Contrairement aux affects dits primaires — la peur, la colère, la joie et la tristesse — la culpabilité fait partie des émotions dites secondaires. Elle suppose une conscience réflexive, une mémoire morale, et une aptitude à se raconter dans un langage normatif : « Ce que j’ai fait n’est pas conforme à ce que j’aurais dû faire. »
Elle implique donc une conscience de soi capable de se juger depuis un ailleurs symbolique, un surplomb intérieur. Elle suppose également l’intériorisation d’une représentation du bien et du mal, et surtout, une faculté à s’imaginer dans le regard d’un autre — qu’il soit réel, symbolique ou transcendant. Paul Ricoeur écrivait justement que la culpabilité est une émotion avec spectateur, même lorsque ce spectateur est intérieur, fruit du dialogue silencieux de soi à soi, et de soi à l’Autre[3].
À ce titre, la culpabilité n’est pas simplement psychique : elle est aussi culturelle. Les anthropologues Ruth Benedict et Margaret Mead ont distingué les cultures de la honte, où le regard extérieur joue un rôle central, des cultures de la culpabilité, fondées sur l’intériorisation de la norme transgressée[4]. Dans ces dernières, le pouvoir moral est incorporé par le sujet lui-même, ce qui peut engendrer tant l’autonomie éthique que l’auto-surveillance punitive[5].
Freud et le Surmoi : le juge intérieur
Freud, dans Le Moi et le Ça (1923), conceptualise le Surmoi comme le prolongement psychique du complexe d’Œdipe. Cette instance morale intériorise les interdits parentaux et devient un juge intérieur, intraitable, exigeant, parfois tyrannique. Le Surmoi n’est pas la culpabilité elle-même, mais il en est l’agent déclencheur : le gardien de l’idéal, le censeur des désirs.
Sa logique n’est ni nuancée ni contextuelle. Elle est absolue. Freud lui-même écrit que le Surmoi peut être impitoyable même en l’absence de faute réelle[6]. Ainsi naissent ces formes pathologiques de la culpabilité, où l’émotion n’est pas liée à une transgression objective, mais à une faute imaginaire.
L’allégeance morale invisible
La culpabilité n’est donc pas toujours l’indice d’un tort. Elle peut être le symptôme d’un conflit plus ancien, plus enfoui : un écart entre ce que je suis et ce que je crois devoir être. Ce décalage révèle l’existence d’une allégeance invisible, contractée parfois dès l’enfance, à des exigences trop lourdes pour être humaines.
À quelles lois intérieures ai-je juré fidélité ? De quelles figures symboliques — parentales, religieuses, sociales — suis-je encore le prisonnier silencieux ? Il arrive que la transformation ne consiste pas à réparer une faute réelle, mais à rompre un pacte ancien. À défaire une fidélité archaïque, que rien ne vient interroger, et qui continue pourtant de gouverner notre auto-jugement.
Quand la culpabilité devient un piège
L’émotion morale peut se travestir en piège psychique. La culpabilité chronique, diffuse, obsessionnelle, cesse d’être éthique : elle devient inhibitrice, déprimante, stérile. Elle n’ouvre ni à la réparation ni à la conscience morale ; elle provoque tristesse, repli et rumination.
Les travaux de Tangney, Stuewig et Mashek ont démontré qu’une culpabilité persistante entraîne une élévation du cortisol, une chute de l’estime de soi et une inhibition comportementale[7]. Dans une étude fascinante, Day et Bobocel ont montré que les individus culpabilisés ont une perception de leur corps comme plus lourd, comme si la dette morale s’inscrivait dans la chair[8].
Deux visages : la culpabilité déontologique et la culpabilité altruiste
Les travaux récents de Mancini et Gangemi[9] permettent de distinguer deux formes fondamentales de la culpabilité. La première est déontologique : elle se déclenche lorsqu’une norme abstraite, souvent religieuse ou idéologique, est transgressée. Elle renvoie au Surmoi, à l’idéal tyrannique, et engendre scrupules, rigidité, culpabilité sans objet.
La seconde est altruiste : elle naît du tort causé à autrui réel. Elle est relationnelle, sensible, potentiellement réparatrice. La première enferme. La seconde relie.
« Chacun de nous est coupable devant tous, pour tous », écrivait Dostoïevski.
Article rédigé par Lucie Lauras
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Transformer la culpabilité : de la paralysie à la responsabilité
La culpabilité, à elle seule, ne constitue ni une élévation morale ni un moteur de transformation. Ressentir une faute ne garantit en rien une évolution intérieure ou relationnelle. Encore faut-il savoir travailler cette culpabilité, l’interroger, et la transfigurer en une force éthique active.
1. Identifier la source de la culpabilité : une démarche éthique
Avant d’agir, il faut comprendre. Identifier l’origine de la culpabilité est une étape essentielle. Karlsson et Sjöberg[10] ont mis en évidence que la mise en mots précise d’une émotion, dans un cadre porteur de sens, contribue à en diminuer la charge affective et à restaurer un sentiment d’efficacité personnelle. Cette verbalisation est un premier acte de souveraineté intérieure.
Mais cette démarche implique une réflexion éthique fondamentale :
- Suis-je responsable d’un tort réel ou simplement fidèle à une exigence intériorisée, transmise, voire archaïque ?
- Ma culpabilité est-elle juste, c’est-à-dire en lien avec une action concrète, ou s’agit-il d’un écran face à un sentiment plus abyssal d’impuissance ?
Autrement dit, toute culpabilité appelle un discernement : est-elle le symptôme d’un conflit intérieur imaginaire ou l’indice d’un manquement réel à l’égard d’autrui ou de soi-même ?
2. De l’émotion à l’action : l’activation du pouvoir d’agir
Graton et Ric ont démontré que le sentiment d’efficacité personnelle, ou auto-efficacité, est un levier déterminant : il permet à la culpabilité de devenir un moteur d’action réparatrice plutôt qu’un facteur d’inhibition ou de résignation[11].
Cependant, il est des situations où rien ne peut être réparé. Le tort est irréversible. L’autre n’est plus là. Le passé est scellé. Dans ces cas, l’action ne peut être que symbolique : pleurer, écrire, parler, créer. Il s’agit alors d’un acte de re-signification : une élaboration symbolique qui restaure une continuité intérieure et offre une possibilité de réconciliation subjective.
3. Une figure littéraire : Jean Valjean, ou la transfiguration de la faute
Victor Hugo illustre ce passage intérieur dans Les Misérables. Jean Valjean est coupable : vol, mensonge, trahison. Pourtant, sa rédemption ne vient ni d’un pardon extérieur, ni de l’oubli, mais d’un engagement actif et répété dans le bien. Il ne devient pas bon en fuyant sa faute, mais en la transformant en responsabilité éthique. Il incarne ainsi la possibilité d’un passage de la culpabilité stérile à une forme de création morale.
De la culpabilité à la responsabilité : une éthique vivante
Bien qu’elle ne figure pas parmi les émotions dites « primaires », la culpabilité occupe une place centrale dans la psyché humaine. Elle révèle la conscience de soi dans le rapport à autrui et la capacité morale à assumer les conséquences de ses actes. Elle n’est pas simplement un produit de l’évolution ou des conventions sociales, mais le signe d’une subjectivité éthique capable de se juger.
La morale conventionnelle repose souvent sur des normes arbitraires, variables selon les cultures et les époques. L’approche émotionnelle que nous défendons ici propose une éthique vivante, fondée sur la responsabilité individuelle face à la complexité du vivant.
Cette posture implique une écoute lucide de l’intériorité : discerner ce qui relève d’une aliénation morale (culpabilité imposée, fantasmatique, héritée) de ce qui appelle un positionnement éthique réel. Ce n’est qu’à cette condition que la culpabilité peut être dépassée et transfigurée.
La culpabilité laissée à elle-même enferme le sujet dans l’isolement, le ressassement et la répétition. Mais lorsque le sujet reprend possession de son intériorité, elle devient responsabilité. Là où la culpabilité fige, la responsabilité engage. Elle ouvre un espace — parfois étroit, mais réel — de transformation et de création.
Ce passage de la culpabilité à la responsabilité marque l’entrée dans une posture d’agent éthique, capable de réparation, d’action juste et de soin, tant de soi que d’autrui.
[1] Sénèque, Lettres à Lucilius.
[2] Sophocle, Œdipe Roi.
[3] Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, 1990.
[4] Benedict, R. (1946). The Chrysanthemum and the Sword ; Mead, M. (1937). Cooperation and Competition among Primitive Peoples.
[5] Michel Foucault, Surveiller et punir, 1975.
[6] Sigmund Freud, Le Moi et le Ça, 1923.
[7] Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2007). Moral emotions and moral behavior. Annual Review of Psychology, 58, 345–372.
[8] Day, M. V., & Bobocel, D. R. (2013). The Weight of a Guilty Conscience: Subjective Body Weight as an Embodiment of Guilt. PLOS ONE, 8(7), e70352
[9] Mancini, F., & Gangemi, A. (2021). Deontological and Altruistic Guilt Feelings: A Dualistic Thesis. Frontiers in Psychology.
[10] Karlsson, G., & Sjöberg, L. G. (2009). The Experiences of Guilt and Shame: A Phenomenological–Psychological Study. Human Studies, 32(4), 335–355.
[11] Graton, A., Ric, F., & Gonzalez, M. (2016). Comprendre le lien culpabilité-réparation : un rôle potentiel de l’auto-efficacité. L’Année Psychologique, 117(3), 379–408.