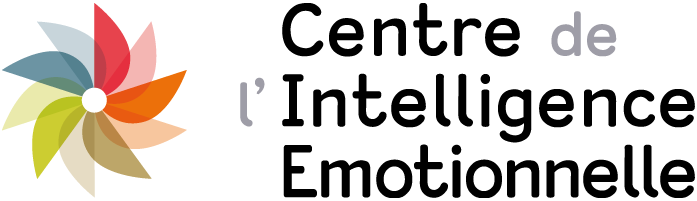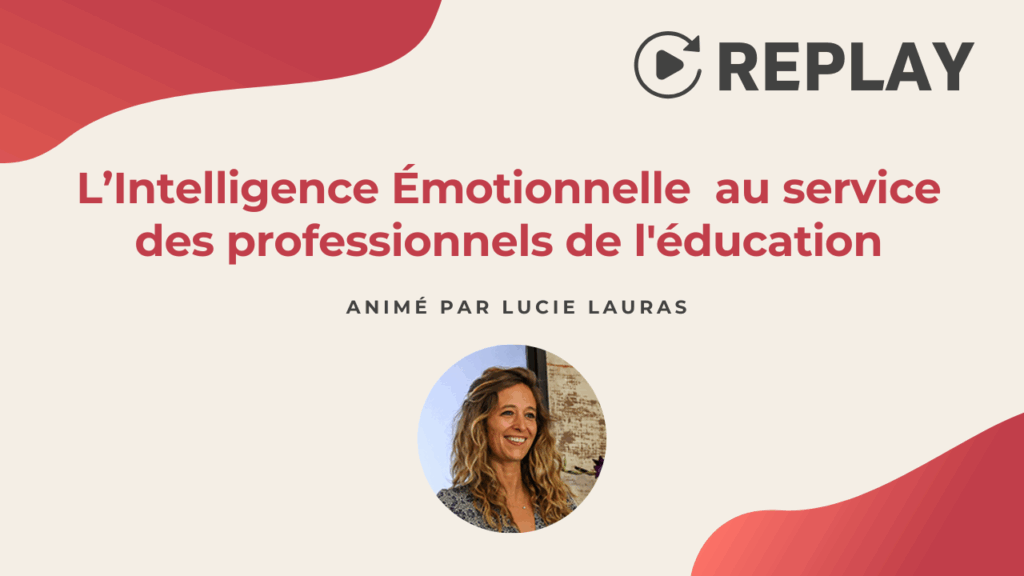Introduction pour mieux vivre certaines émotions
Depuis quelque temps, je vous invite à regarder autrement certaines émotions. Celles qu’on juge « mauvaises », celles qu’on préfère cacher, celles qui dérangent.
Mais au fond, qu’est-ce qu’une « mauvaise » émotion ? Pourquoi certaines ont-elles si mauvaise réputation ?
Qui n’a jamais entendu qu’il ne faut pas être jaloux ? Ou que la rancune est un vilain défaut ?
Je veux vous parler de ces émotions que la société, l’entourage ou même cette petite voix intérieure jugent « négatives », parfois toxiques, voire moralement inacceptables. Derrière ces jugements, souvent implicites mais profondément ancrés, se dessine une vision binaire des émotions : certaines seraient acceptables, d’autres à bannir. Certaines sont même diabolisées au point d’être associées aux péchés capitaux, comme l’envie ou la paresse. Pas étonnant, alors, que les ressentir suscite de la culpabilité, comme si c’était une faute, une faiblesse, voire un signe d’immaturité.
Mais alors comment réussir à les vivre sereinement lorsqu’elles surgissent ? Puisqu’elles surgissent. Plutôt que de les dissimuler, les minimiser ou les laisser exploser de manière incontrôlée ou inappropriée, pourquoi ne pas changer de regard ?
Les comprendre, leur redonner une place légitime, c’est peut-être la clé pour mieux les accueillir, les normaliser… et s’en libérer.
Car une émotion, en soi, n’est jamais un problème. Mais tout dépend de ce que l’on en fait ensuite.
Les émotions primaires et secondaires
En poursuivant cette exploration des émotions – notamment l’amertume et la rancune, sur lesquelles je travaille actuellement – une introduction nécessaire s’est imposée : avant d’analyser ces ressentis, il est essentiel de comprendre leur nature et leur dynamique.
Certaines émotions qualifiées de « mauvaises », « négatives » ou « désagréables » appartiennent généralement à la catégorie des émotions secondaires. Contrairement aux émotions primaires, identifiées par le psychologue Paul Ekman[1], elles ne sont pas innées mais résultent de la transformation des émotions primaires sous l’influence de l’environnement culturel, de l’éducation et du vécu personnel. Elles émergent d’une combinaison plus complexe, façonnée par l’interprétation et la cognition. Contrairement aux émotions primaires, elles ne sont pas simplement déclenchées par des stimuli immédiats mais impliquent une évaluation consciente ou inconsciente de la situation.
Ainsi, la jalousie peut être comprise comme une transformation de la peur (crainte de perdre quelqu’un ou quelque chose), mêlée à de la tristesse et de la colère. De même, la honte se construit à partir d’une expérience de peur ou de dégoût, tournée cette fois vers soi-même sous l’influence des normes sociales.[2]
Cette distinction est essentielle pour comprendre l’expérience émotionnelle humaine dans toute sa complexité. Les émotions secondaires ne sont pas des réactions directes à un événement, mais des constructions élaborées qui traduisent des influences sociales, culturelles et personnelles. Les considérer sous cet angle permet de les percevoir non pas comme des « défauts » à corriger, mais comme des manifestations normales de la vie émotionnelle, façonnées par l’expérience et l’environnement.
Elargir l’espace entre émotion et action
Ensuite, il me semble indispensable de préciser que l’étymologie du mot émotion, issue du latin movere (« mettre en mouvement »), met en évidence le lien étroit entre émotion et action. L’une des fonctions premières d’une émotion est donc de préparer une réponse comportementale adaptée. D’un point de vue très schématique, elles peuvent être regroupées en deux messages simples mais efficaces : « ça va » (absence de danger) et « ça ne va pas » (perception d’un danger).
Les émotions secondaires constituent donc des formes spécifiques que prennent ces dynamiques de base en fonction du contexte et de l’expérience individuelle. L’impatience par exemple traduit souvent une peur face à l’incertitude ou une volonté de contrôle sur une situation perçue comme instable[3]. Les pensées qui accompagnent ces émotions ne sont alors que des perceptions influencées par l’émotion elle-même. Une personne qui ressent de la jalousie interprète son environnement à travers ce filtre émotionnel, ce qui façonne ses jugements et ses réactions.
Alors plutôt que de juger une émotion comme « mauvaise », une approche plus constructive consiste à s’interroger sur son origine profonde : quelle peur ou quel besoin non satisfait cherche-t-elle à exprimer ? Identifier cette dynamique permet de prendre du recul et d’agir de manière plus ajustée, afin que l’émotion ne devienne pas une source de tension excessive ou de mal-être. Loin d’être un obstacle, elle peut ainsi devenir un indicateur précieux pour mieux comprendre ses propres mécanismes internes et adapter ses réponses.
Sommes-nous nos émotions ?
Une autre réflexion m’est venue en réalisant que le langage enferme souvent les émotions dans l’identité même de la personne : “il est comme ça, il est jaloux”, “quelle rancunière ! “, « Elle a toujours été impatiente » … Comme si un ressenti passager pouvait définir un individu alors qu’une émotion n’est rien d’autre qu’un signal, une manifestation éphémère…
La question s’est particulièrement posée à propos du pessimisme. Est-ce une émotion ou un trait de personnalité ? Cette distinction peut sembler floue. Le pessimisme peut être perçu comme un état émotionnel, lorsqu’il est ponctuel et contextuel, mais il devient un trait de personnalité lorsqu’il s’installe durablement dans la manière d’interpréter le monde. Comme pour de nombreuses émotions, tout dépend du temps qu’elle occupe et de l’importance qui lui est accordée. Lorsqu’une émotion est répétée et entretenue, elle peut progressivement façonner une attitude ou une disposition d’esprit durable.
Ce qui importe avant tout, c’est de comprendre que toute émotion, qu’elle soit passagère ou persistante, a une origine et un message. Certaines peuvent déclencher des réactions impulsives, parfois inadaptées ou nuisibles (pour soi et/ou pour les autres). Identifier et accueillir ces émotions sans les laisser nous définir permet de les normaliser et d’éviter qu’elles ne dictent les comportements de manière automatique.
Pour une meilleure compréhension des émotions
L’objectif de cette série d’articles est donc d’explorer ces émotions à mauvaise réputation pour mieux :
✔ Les identifier : pour comprendre l’émotion qui se présente, sans jugement.
✔ Les normaliser : une émotion n’est qu’une émotion…
✔ Les traiter : agir pour éviter que l’émotion s’installe et prenne les commandes
Aucune émotion n’est une ennemie ou un défaut. En les distinguant, en les remettant à leur juste place, il devient possible d’en tirer un enseignement utile pour les transformer ou les libérer.
Article rédigé par Lucie Lauras
[1] Ekman, Paul. Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. Owl Books, 2003.
[2] Scherer, K.R. (2009). The dynamic architecture of emotion: Evidence for the component process model. Cognition and Emotion, 23(7), 1307-1351.)
[3] (Lazarus, R.S. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford University Press.)