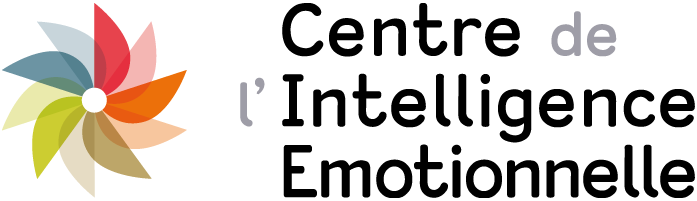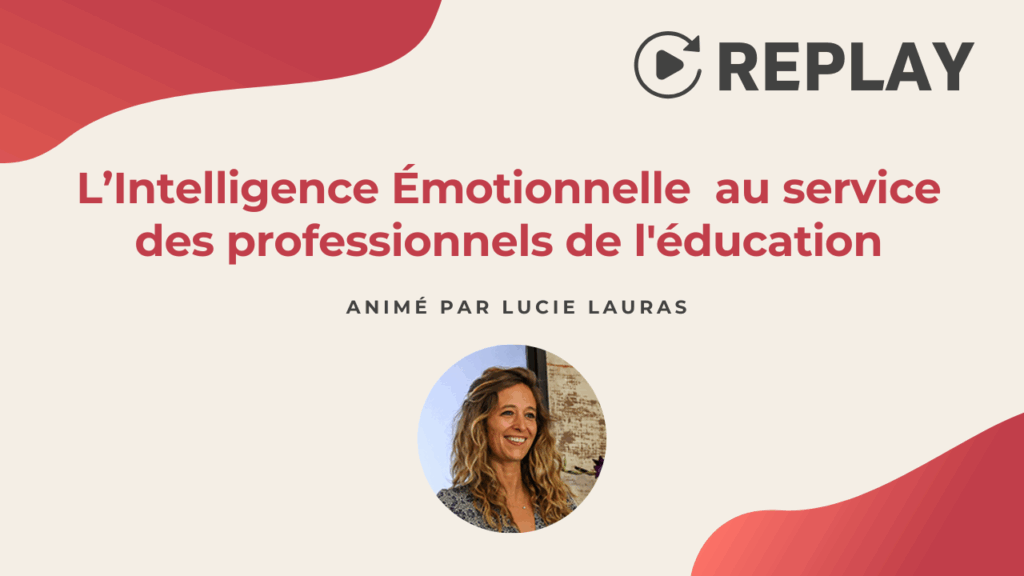Ces émotions qui ont mauvaise réputation : La honte
Dans la vaste palette des émotions humaines, certaines sont perçues comme inconvenantes, immatures, voire moralement répréhensibles, et finissent par être reléguées aux marges de ce qui est socialement acceptable. Prenons la jalousie par exemple qui peut être considérée comme toxique ou encore l’envie, tout de même liée aux péchés capitaux, qui est fréquemment décriée comme une expression d’avidité condamnable. Ces émotions stigmatisées peuvent ainsi susciter un profond malaise, non seulement chez ceux qui les ressentent, mais également chez ceux qui en sont témoins. Jugées indésirables, elles peuvent devenir sources de souffrance, menant parfois jusqu’au rejet ou au déni.
Cette année, à travers une série d’articles, je vous propose de revisiter ces émotions mal-aimées. Ensemble, nous questionnerons les jugements qui les entourent et leur accorderons une attention bienveillante et constructive. Mon ambition ne se limite pas à leur réhabilitation : je souhaite les reconnaître comme des composantes essentielles et enrichissantes de notre expérience humaine, bien plus que de simples perturbations à éviter.
Plutôt que de les craindre, de les fuir ou d’en ressentir de la honte, nous pouvons choisir de les explorer sous un angle nouveau. En identifiant leurs racines, en décryptant les messages qu’elles nous transmettent et en observant leurs manifestations, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Cette démarche peut transformer ces émotions en de véritables leviers de maturité, de résilience et de force intérieure.
Pour entamer cette exploration, commençons justement par la honte.
La honte est une émotion souvent difficile à vivre, pourtant elle joue un rôle crucial en dévoilant ce qui se passe dans les profondeurs de notre psyché. Elle reflète nos vulnérabilités, nos aspirations, mais aussi nos valeurs les plus profondes. En mettant en évidence la tension entre le moi idéal et le moi réel, la honte agit comme un révélateur de nos conflits internes nous invitant à mieux comprendre les dynamiques invisibles qui nous façonnent.
Une émotion sociale
La honte se distingue par son impact sur la perception de soi. Contrairement à la culpabilité, qui concerne davantage les actes, la honte touche au cœur de l’identité et remet en question la valeur personnelle. Cette émotion trouve souvent sa source dans des expériences sociales où l’individu se sent jugé ou révèle une faiblesse perçue comme intolérable aux yeux d’autrui.
Les travaux de Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité et de la honte, illustrent que la honte est intrinsèquement liée à la peur de la déconnexion. Selon elle, nous ressentons de la honte lorsque nous croyons ne pas être dignes d’amour ou d’appartenance[1].
Dans La Honte d’Annie Ernaux, l’écrivaine décrit en effet comment un événement familial traumatique a cristallisé un sentiment durable d’infériorité. Ce récit montre que la honte peut devenir une entrave à la réalisation de soi lorsque les jugements externes se mêlent aux blessures personnelles.
La honte dans le contexte culturel et sociétal
Serge Tisseron, psychanalyste, a mis en lumière la dimension collective de la honte, affirmant qu’elle n’est jamais une émotion purement individuelle, mais profondément influencée par les normes et attentes sociétales[2]. Les tabous, les standards esthétiques, ainsi que les injonctions sociales autour de la réussite et du comportement, façonnent les perceptions de ce qui est acceptable ou non. Ces cadres normatifs poussent les individus à internaliser certaines expériences comme honteuses, notamment lorsque celles-ci vont à l’encontre des attentes collectives.
Ainsi, la honte devient un miroir déformant, renvoyant non pas une image de soi authentique, mais une projection des jugements perçus ou réels d’autrui[3]. Par exemple, dans les sociétés où l’apparence physique est particulièrement valorisée, les personnes ne correspondant pas aux idéaux de beauté peuvent ressentir une honte omniprésente et invalidante.
Origines et mécanismes de la honte
La honte trouve souvent ses racines dans l’enfance, une période charnière où l’estime de soi se construit à travers les interactions avec les figures d’attachement. Des études montrent que lorsque l’enfant est soumis à des expériences répétées d’humiliation, de critiques ou de rejet, son cerveau en développement intègre ces épisodes comme des signaux de menace pour sa valeur personnelle. Cette construction neurologique repose en partie sur l’amygdale, qui stocke les souvenirs émotionnels, et sur le cortex préfrontal, qui intervient dans leur régulation[4].
John Bowlby, pionnier de la théorie de l’attachement, a souligné que les réponses bienveillantes et sécurisantes des figures parentales sont cruciales pour bâtir un sentiment de sécurité émotionnelle[5]. À l’inverse, l’absence de validation ou une rupture dans la relation d’attachement peut entraîner une honte durable, souvent vécue comme une défense inconsciente visant à préserver le lien, même au prix d’un effacement de soi[6].
Le psychologue Paul Gilbert a exploré cette émotion dans une perspective évolutive. Il explique que, dans des contextes primitifs, la honte jouait un rôle adaptatif, permettant à l’individu de signaler au groupe son acceptation des normes et d’éviter l’exclusion[7]. Toutefois, dans les sociétés modernes, cette fonction peut devenir dysfonctionnelle, notamment lorsque la honte est intériorisée de manière excessive ou associée à des attentes irréalistes.
Quelques pistes pour s’en libérer
Reconnaître et accepter la honte est une étape incontournable pour avancer. Cela passe par l’accueil de cette émotion, sans jugement, permettant une réinterprétation et, à terme, une libération.
–> L’expression
Boris Cyrulnik souligne l’importance cruciale de l’expression dans le processus de résilience émotionnelle[8]. Selon lui, partager une expérience douloureuse permet non seulement de soulager la charge émotionnelle qu’elle représente, mais aussi d’en réinterpréter le sens de manière plus apaisée. Il cite dans ses récits des exemples où des individus, grâce à l’expression verbale, ont transformé leur souffrance en une ressource précieuse pour avancer et reconstruire leur estime de soi.
L’écriture et l’art jouent aussi un rôle clé dans ce processus. Des œuvres comme La Honte d’Annie Ernaux ou Le Consentement de Vanessa Springora montrent comment l’écriture peut transformer une douleur intime en une forme de création libératrice. En racontant leurs expériences, ces autrices transforment leur souffrance en réflexion et en puissance, tout en offrant un message universel de résilience.
–> La mise à distance par l’autocompassion
Selon Kristin Neff[9], spécialiste de l’autocompassion, apprendre à se traiter avec douceur et indulgence aide à transformer la honte en une prise de conscience bienveillante. Elle recommande des exercices de pleine conscience pour cultiver une relation plus apaisée avec soi-même.
–> La réévaluation cognitive
Des techniques telles que le recadrage cognitif et l’identification des distorsions cognitives peuvent aider à repérer les schémas de pensée dysfonctionnels associés à la honte et de les déconstruire.
–> La création de nouveaux récits
L’approche narrative, développée par Michael White et David Epston, invite à réécrire l’histoire de ses expériences pour se repositionner en acteur de sa vie. Réévaluer son parcours en intégrant des éléments de force et de résilience permet de diminuer le poids des souvenirs négatifs.[10]
–> La connexion sociale
Les groupes de parole, les associations ou les cercles de soutien sont des moyens puissants de normaliser l’expérience de la honte et de favoriser un sentiment d’appartenance. Selon Johann Hari[11], le soutien communautaire est essentiel pour redonner du sens à des parcours marqués par la honte et restaurer un sentiment d’appartenance et de valeur personnelle.
Conclusion
La honte, bien qu’elle soit souvent difficile à accepter, joue un rôle central dans les dynamiques émotionnelles et relationnelles. Elle témoigne, d’une part, d’une atteinte à l’estime de soi et, d’autre part, peut être le reflet d’un poids transmis par autrui ou par le contexte social. C’est pourquoi il est essentiel de la reconnaître et de l’aborder avec délicatesse. Lorsqu’elle est mise en lumière et travaillée dans un cadre bienveillant, comme à travers des démarches introspectives ou des échanges collectifs, elle devient un point de départ ouvrant la voie vers une libération profonde.
Article rédigé par Lucie Lauras
[1] Brené Brown, The Gifts of Imperfection.
[2] Tisseron, S. (2013). La Honte. Éditions Albin Michel.
[3] Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2002). Shame and Guilt: Emotions and Social Behavior. Guilford Press.
[4] Siegel, D. J. (2012). The Developing Mind.
[5] Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development.
[6] Winnicott, D. W. (1965). The Maturational Processes and the Facilitating Environment.
[7] Gilbert, P. (2009). The Compassionate Mind
[8] Boris Cyrulnik,. Les Vilains Petits Canards et Un merveilleux malheur.
[9] Kristin Neff, Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself.
[10] Michael White et David Epston, Narrative Means to Therapeutic Ends.
[11] Johann Hari, Lost Connections: Uncovering the Real Causes of Depression — and the Unexpected Solutions.