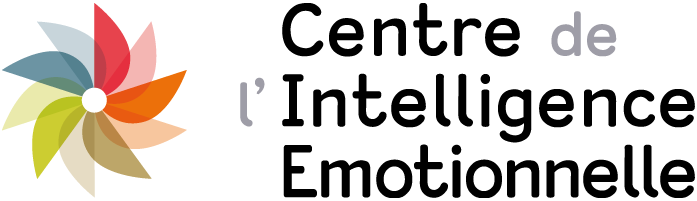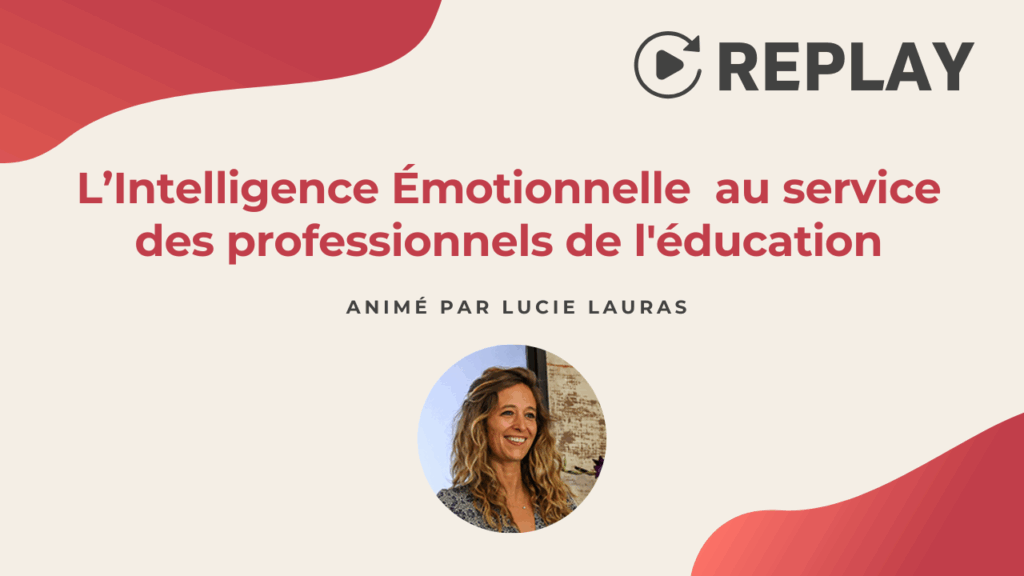Le Sens de la Réalité : illusion ou compétence essentielle ?
Le réel existe-t-il ? Pouvons-nous véritablement y accéder ? Notre perception du monde est-elle une représentation objective de la réalité ou le fruit d’une construction façonnée par notre subjectivité ?
Plutôt que de chercher une réponse définitive, nous pouvons poser une problématique à partir d’un constat : certaines personnes parviennent mieux que d’autres à s’orienter avec succès dans le monde. Cette capacité repose sur une compétence bien réelle : le sens de la réalité (reality testing en anglais)[1]. Il s’agit de notre aptitude à articuler nos ressentis, nos pensées et nos émotions, afin d’exercer un jugement éclairé et de prendre des décisions adaptées. Car si nos sens nous sont indispensables pour appréhender notre environnement, ils n’en restent pas moins faillibles et parfois trompeurs.
Développer cette compétence, ce n’est pas prétendre accéder à une vérité absolue, bien au contraire, puisqu’il s’agit de chercher à :
- Différencier les faits des interprétations subjectives.
- Prendre conscience de l’influence des biais cognitifs et des émotions sur notre perception.
- Affiner notre compréhension du monde pour prendre des décisions plus justes et nuancées.
Issu des travaux du Comité de Recherche du Centre de l’Intelligence Émotionnelle, cet article explore cette compétence clé et souligne son rôle fondamental dans notre discernement et notre rapport à la réalité.
La Réalité : Déformée par Notre Subjectivité ?
Prenons un exemple simple : une personne reste convaincue qu’il fera beau demain, alors que toutes les prévisions météorologiques annoncent un déluge. Pourquoi s’accroche-t-elle à cette certitude malgré les éléments qui prouvent le contraire ? Peut-être parce qu’elle ne veut pas remettre en question ses plans, ou qu’elle accorde plus de crédit à son ressenti qu’aux données disponibles.
Ce type de situation nous invite à une réflexion plus large : percevons-nous le monde tel qu’il est, ou tel que nous avons besoin qu’il soit ? Nos attentes, nos émotions et nos expériences façonnent notre rapport au réel, souvent de manière subtile et inconsciente.
Comme le souligne cette citation : “Nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont, nous les voyons telles que nous sommes.”[2]
Cela ne signifie pas que toute perception soit erronée ou illusoire, mais il semble essentiel de garder à l’esprit que notre vision du monde est toujours, d’une certaine manière, une construction subjective. Nous ne regardons pas la réalité à travers une vitre parfaitement transparente, mais à travers le prisme de notre propre histoire, de nos émotions et de nos croyances.
Une Question Philosophique
Depuis l’Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur la nature de la vérité et sur la fiabilité de notre perception du monde. Tous s’accordent sur le caractère potentiellement trompeur de nos sens.
À l’image des prisonniers enfermés dans la caverne, Platon[3] nous met en garde contre l’illusion de nos perceptions. Selon lui, l’accès à la vérité exige de se détacher des sens et d’adopter un raisonnement fondé sur la dialectique. Aristote[4], en revanche, s’opposera à cette vision en réhabilitant le sensible et l’expérience comme seuls moyens d’atteindre le réel.
La deuxième problématique concerne la nature même du réel. Toute la philosophie antique repose sur le paradigme d’un réel donné, que l’homme tente de comprendre et d’expliquer. Ce paradigme sera profondément bouleversé par la philosophie moderne.
Ainsi, David Hume[5], philosophe empiriste, considère nos vérités comme de simples croyances, de pures illusions, conduisant à un nihilisme du réel. La rupture définitive se produit avec Kant[6], qui reconnaît l’existence d’un réel (le noumène), mais affirme qu’il est inaccessible à l’homme. Le réel n’est plus une donnée originelle, mais une construction façonnée par notre raisonnement. L’homme n’a accès qu’aux phénomènes, c’est-à-dire à une expérience du réel filtrée par son propre prisme cognitif.
Pour tenter de dépasser cette problématique, Husserl[7] développera la phénoménologie, selon laquelle la seule réalité est notre expérience : le phénomène.
Prendre conscience de ces limites ne signifie pas sombrer dans un relativisme absolu, mais plutôt cultiver une posture d’humilité et de questionnement face à ce que nous tenons pour acquis.
Le Poids des Émotions et des Biais Cognitifs
Notre perception du monde semble donc loin d’être une représentation neutre et objective.
Nos émotions, notre état d’esprit et nos biais cognitifs influencent profondément la manière dont nous interprétons les faits et construisons nos croyances. Ces filtres, souvent inconscients, jouent un rôle bien plus déterminant qu’on ne l’imagine dans notre compréhension du réel.
Deux tendances opposées pour illustrer ces distorsions perceptuelles :
- Un sens aigu de la réalité, lorsqu’il est accompagné d’un optimisme trop faible, peut entraîner une focalisation excessive sur les risques et les menaces, limitant ainsi l’audace et la capacité d’adaptation.
- À l’inverse, un optimisme excessif, qui altère la perception du réel, peut conduire à une sous-estimation des difficultés et à des prises de décisions imprudentes.
Ainsi, ni l’optimisme ni le pessimisme ne sont intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont des stratégies d’adaptation, dont l’efficacité dépend du contexte et des circonstances.
Le sens de la réalité au service de la prise de décision
En partageant son expérience de golfeuse, Sophie Giquel[8] illustre parfaitement la dynamique entre intuition et raisonnement dans la prise de décision. Sur le parcours, elle ne se fie pas uniquement à son ressenti : elle croise son propre jugement avec l’analyse extérieure de son caddie.
D’un côté, son intuition, nourrie par des années d’expérience, lui permet d’anticiper ses coups et de ressentir naturellement les subtilités du jeu. De l’autre, son caddie apporte un regard plus objectif, en prenant en compte des éléments plus difficiles à percevoir sur le moment, comme la force du vent ou la topographie du terrain.
C’est cette complémentarité entre instinct et analyse qui affine ses décisions et optimise ses performances.
Le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman[9] a en effet identifié deux systèmes cognitifs qui influencent nos choix :
Système 1 : rapide, intuitif, basé sur l’expérience et les automatismes. Il est efficace pour les décisions courantes mais peut être biaisé par des raccourcis cognitifs. Système 2 : plus lent, analytique et rationnel, mobilisé lorsque nous devons traiter une situation nouvelle ou complexe. Il demande plus d’effort, mais permet une réflexion plus approfondie.
Si l’intuition est précieuse lorsqu’on maîtrise un domaine, elle peut toutefois induire en erreur face à des situations inédites ou ambiguës. Une décision purement intuitive peut être influencée par des biais cognitifs ou une confiance excessive dans ses automatismes. Lorsque les enjeux sont élevés et les incertitudes nombreuses, il est souvent plus sûr d’adopter une approche analytique, d’explorer plusieurs hypothèses et de confronter ses idées aux faits.
Le feedback : un miroir nécessaire pour ajuster sa perception
Si notre regard sur le monde est souvent subjectif, le retour des autres peut nous aider à affiner notre vision. Comme un golfeur qui s’appuie sur l’analyse de son caddie pour ajuster son coup, nous avons tout intérêt à confronter nos interprétations à d’autres perspectives.
Le feedback nous permet de :
- Identifier nos angles morts et repérer d’éventuels biais dans notre raisonnement.
- Prendre conscience de l’écart entre notre perception et celles des autres.
- Enrichir notre compréhension en intégrant des points de vue différents.
Bien sûr, recevoir un retour critique n’est pas toujours confortable. Pourtant, savoir l’accueillir avec ouverture et réflexion, sans le percevoir comme une remise en question personnelle, est une compétence précieuse. L’objectif n’est pas d’accepter toutes les opinions sans discernement, mais d’apprendre à filtrer, analyser et intégrer celles qui peuvent nous aider à ajuster nos choix.
Ancrer ses décisions dans un plan d’action réaliste
Prenons l’exemple d’une étudiante aspirant à devenir médecin. Elle ne peut pas se contenter d’espérer réussir. Pour maximiser ses chances, elle doit structurer son quotidien en fonction de son objectif : sélectionner les matières adéquates, organiser efficacement son temps de travail et accepter les sacrifices nécessaires. En mettant en place une stratégie concrète et adaptée, elle transforme son ambition en un projet réalisable et cohérent.
Cette approche repose sur trois piliers fondamentaux :
- Une orientation claire : savoir où l’on veut aller et pourquoi.
- Des données fiables : s’appuyer sur des éléments concrets plutôt que sur des suppositions.
- Une évaluation réaliste des contraintes : intégrer les obstacles et les ressources disponibles pour ajuster ses choix au cours du temps.
Le sens de la réalité au service de la régulation émotionnelle
Si raison et intuition se complètent dans la prise de décision, le sens de la réalité joue également un rôle clé dans la régulation émotionnelle. Face à une situation stressante, notre réaction immédiate est souvent guidée par nos automatismes, influencés par nos expériences et nos croyances. Pourtant, cette première lecture peut être trompeuse.
Développer son sens de la réalité, c’est apprendre à interroger ses émotions et à ne pas se fier uniquement à son ressenti immédiat. C’est une gymnastique mentale qui permet d’aborder les situations avec plus de discernement et d’éviter les réactions impulsives basées sur des perceptions erronées.[10]
Conclusion
Développer son sens de la réalité, c’est apprendre à distinguer les faits des interprétations, à remettre en question ses automatismes de pensée et à ajuster sa perception en fonction d’éléments concrets. Ce n’est pas renier ses émotions ou son intuition, mais les compléter par une analyse rationnelle.
Dans un monde saturé d’informations et d’opinions, cultiver cette capacité permet de naviguer avec plus de clarté et de justesse. En adoptant une posture d’écoute, de réflexion et d’ajustement, nous affinons notre compréhension du monde et améliorons nos décisions, qu’elles concernent notre carrière, nos relations ou notre bien-être personnel.
[1] La compétence sens de la réalité du modèle de Reuven Bar-On est définie comme la capacité à rester objectif en percevant les choses telles qu’elles sont réellement. Cela implique de reconnaître quand nos émotions ou nos biais personnels peuvent altérer notre objectivité.
[2] Citation attribuée à Anaïs Nin, écrivaine.
[3] Platon, La République, Livre VII, allégorie de la caverne
[4] Aristote, Métaphysique, Livre I
[5] David Hume, Enquête sur l’entendement humain (1748)
[6] Emmanuel Kant, Critique de la raison pure (1781).
[7] Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie (1913)
[8] Sophie est membre du comité de Recherche
[9] Daniel Kahneman – Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée
[10] Pour en savoir plus sur la régulation émotionnelle : Les stratégies de régulation émotionnelle | LinkedIn